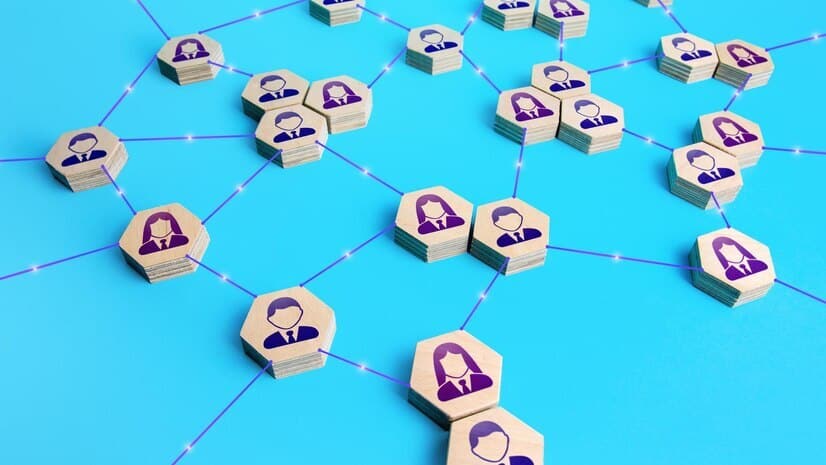Les liens faibles : petits mais costauds ?
Largement ignorés par la réflexion éthique et politique, les « liens faibles » sont pourtant au cœur des formes contemporaines d’attachement et d’attention aux autres : dans les réseaux sociaux, dans la sphère culturelle, dans notre rapport à l’espace urbain ou à l’environnement, ou encore